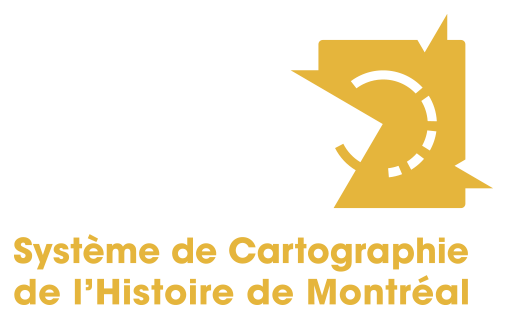- Historien
- Maîtrise Histoire (Université Laval)
Téléphone : 819-503-7402
Courriel : alroy.hst@videotron.ca
Page Academia
Champs de spécialisation
- Histoire culturelle, Québec, 20e siècle
- Commémoration, mémoire, patrimonialisation et politiques du patrimoine
- Patrimoine viaire
- Histoire de l’Amérique française et francophonie canadienne
- Histoire urbaine (ville de Québec, ville de Montréal)
- Histoire publique
Principales réalisations
Après avoir complété sa maîtrise en histoire sur la patrimonialisation du Vieux-Québec (Université Laval, 1995), Alain Roy a œuvré pendant de nombreuses années comme consultant en histoire, patrimoine et muséologie, notamment au sein de la firme Histoire plurielle, puis comme archiviste et analyste à Bibliothèque et Archives Canada. Maintenant à la retraite, il poursuit divers projets.
Il s’intéresse notamment aux enjeux de mémoire, de commémoration et de patrimonialisation, tant au Québec que parmi les communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Le patrimoine viaire de même que l’histoire urbaine, particulièrement celles de Québec et de Montréal, ont aussi été au cœur de ses recherches. Plus récemment, c’est le chantier de la participation citoyenne en histoire et patrimoine qui retient son attention.
Principaux projets de recherche en cours
De l’histoire « antiquaire » à l’histoire citoyenne
Dans le cadre du projet Agents mémoriels, un engagement citoyen d’hier à aujourd’hui, qu’il codirige avec Martin Drouin et MariFrance Charette, Alain Roy s’intéresse d’abord aux transformations survenues dans les pratiques citoyennes de l’histoire depuis le XIXe siècle. Alors que le développement récent des sciences citoyennes ou participatives nous permet de dépasser l’antinomie entre amateur et professionnel, ou encore entre histoire et mémoire, il entend jeter un regard neuf sur ces pratiques culturelles et revenir sur leur évolution afin d’en dégager les tendances, les apports et les limites.
Le chantier a d’ores et déjà produit d’importants résultats. Ainsi, la contribution d’Alain Roy a donné lieu à différentes publications : outre le dossier sur la participation citoyenne publié dans Histoire Québec qu’il a codirigé, il a publié des articles sur l’évolution des sociétés d’histoire (Histoire Québec, 27,3 (2022)), sur l’histoire de la Fédération Histoire Québec (Cap-aux-Diamants, 151 (2022)) ou sur l’histoire comme pratique culturelle (Histoire Québec, 29,1 (2023)). Sont sous presse des notes de recherche sur les monographies dites de paroisse (Revue d’histoire de l’Amérique française, 2024) et sur la politique de participation citoyenne à la gestion du patrimoine du MCCQ (In situ, revue des patrimoines, 2024).
De plus, dans le cadre de ce projet, il a présenté, seul ou avec l’équipe, des communications dans différents forums depuis 2020. Il contribue également au volet Engagement du chantier Agents mémoriels. Ce volet, codirigé par Martin Drouin et Richard Smith, est financé depuis 2022 par un programme pilote en sciences participatives des Fonds de recherche du Québec (FRQ). Cette recherche entend documenter, de manière participative, l’apport des sociétés d’histoire à la mémoire québécoise.
Une autre réalisation de l’équipe est l’organisation en partenariat d’un colloque sur la participation citoyenne à l’automne 2023. Réunissant près de 150 personnes, ce fut un franc succès.
Chemins anciens et paysages du mouvement : histoire, traces et mémoire
Sentiers, portages et routes anciennes sont, tout comme le patrimoine bâti, des vestiges concrets de l’appropriation du territoire et de sa transformation en paysage humanisé. Chargées symboliquement et souvent éléments d’identité, ces trames d’occupation restent pour autant méconnues. Alors que des approches plus systémiques du paysage humanisé, tant urbain que national, sont à l’ordre du jour, le patrimoine viaire, qui en est une constituante majeure, mérite un regard attentif. Dans cette perspective, Alain Roy a coorganisé avec Alain Gelly, également cochercheur au LHPM, mais aussi avec d’autres partenaires, dont la Fédération Histoire Québec et le Centre interuniversitaire d’études québécoises, les Journées d’échange Paysages du mouvement / Paysages en mouvement en octobre 2019, qui furent un franc succès. Y ont donné suite un numéro de la revue Histoire Québec (vol. 25, no 2, 2020) puis un volume publié en 2021 sous la direction de Alain Roy, Alain Gelly, Maude-Emmanuelle Lambert et Richard M. Bégin, et qui s’intitule Paysages du mouvement / paysages en mouvement. Trajectoires, perspectives et panoramas. De plus, les sommes accumulées pendant le colloque ont permis la création des prix d’excellence Paysages du/en mouvement. Un séminaire de recherche a également été tenu sous les auspices du Laboratoire en novembre 2022 pour voir les suites à donner au colloque. Un comité a élaboré par la suite une grille d’évaluation des voies anciennes, un outil vu essentiel pour identifier et caractériser ce patrimoine.
La recherche se poursuit toujours, car partie fondamentale de notre occupation du territoire, le réseau viaire ancien structure à la fois notre occupation du territoire et notre perception du paysage humanisé. Il demeure pourtant largement méconnu.
Le marché Sainte-Anne, le parlement et Montréal-Capitale (axe 2)
Dans le cadre du Partenariat de recherche Montréal, plaque tournante des échanges : histoire, patrimoine, devenir, ce projet de recherche, mené conjointement avec Pointe-à-Callière, vise à documenter d’une part l’évolution d’un site au cœur de l’histoire du Vieux-Montréal et, d’autre part, à jeter un regard neuf sur cette époque cruciale pour l’histoire canadienne qu’est la période où Montréal fut capitale.
Dans le cadre de ce projet qu’il a codirigé avec Joanne Burgess et Louise Pothier, Alain Roy s’est intéressé à divers aspects de cette décennie « capitale », donnant lieu à de nombreuses contributions. Il s’est intéressé tout d’abord aux conséquences de l’incendie du Parlement, en particulier sur la relation avec l’Empire britannique. Il en a résulté un chantier, soutenu par le Laboratoire, sur les 240 adresses et pétitions (voir l’application numérique) et un article dans la Revue d’histoire de l’Amérique française (2016), mais aussi des articles sur le statut et l’aménagement de Kingston et Montréal comme capitale (Revue d’histoire urbaine, 2018), sur le travail au parlement (Bulletin d’histoire politique, 2017) ou sur le palais de justice. Outre des articles dans différents magazines, il a aussi rédigé de nombreux textes dans le magnifique ouvrage Montréal, capitale. L’exceptionnelle histoire du site archéologique du marché Sainte-Anne et du parlement de la province du Canada, publié en 2021 aux Éditions de l’homme sous la direction de Louise Pothier.
Mémoire et patrimoine des communautés linguistiques minoritaires
L’insertion des sociétés contemporaines dans le temps est un élément fondamental de leur identité, qui conditionne les pratiques sociales entourant la mémoire collective, son rapport à l’histoire ainsi qu’avec les traces du passé qui subsistent dans le paysage. Ancrées dans des espaces concrets, ces pratiques mémorielles nous informent alors tant sur l’évolution d’un lieu que sur la société dans laquelle il s’insère. Or, qu’en est-il des communautés linguistiques en milieu minoritaire ? Alors que leur vitalité a été l’objet de nombre d’études, la dimension historique et patrimoniale a longtemps été négligée. Afin de corriger la situation, Alain Roy a rédigé un rapport de recherche proposant une nouvelle approche, basée sur le concept de vitalité mémorielle. Ce rapport, publié par Bibliothèque et Archives Canada en 2021, est intitulé De la vitalité à la vitalité mémorielle. Fondements conceptuels de la place de la mémoire et du patrimoine dans l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). La réflexion s’est poursuivie avec la publication d’articles dans divers ouvrages collectifs, mais aussi dans la revue Minorités linguistiques et société /Linguistic Minorities and Society (2023) ou la Revue du Nouvel-Ontario (à paraître).
Publications
Consulter la liste complète des publications
- ROY, Alain, « De la vitalité à la vitalité mémorielle, ou comment appréhender l’inscription dans le temps des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) », Minorités linguistiques et société /Linguistic Minorities and Society, numéro spécial sur le thème Patrimoine, mémoire et vitalité des minorités linguistiques en situation minoritaire dirigé par Patrick Donovan, Éric Forgues et Lorraine O’Donnell, 2023.
- ROY, Alain, « Le réseautage, un soutien essentiel aux bibliothèques oeuvrant en milieu francophone
minoritaire au Canada. À propos du Réseau des bibliothèques des communautés de langue
officielle en situation minoritaire (CLOSM) de BAC », Documentation et bibliothèques, vol. 68, no 3, 2022, p. 37-46. - ROY, Alain, GELLY, Alain, LAMBERT, Maude-Emmanuelle et Richard M. BÉGIN (dir.), Paysages du mouvement/ paysages en mouvement. Trajectoires, perspectives et panoramas, Montréal, Éditions Histoire Québec, coll. Fédération Histoire Québec, 2021, 244 p.
- ROY, Alain, « Planifier et aménager une capitale éphémère: Kingston, Montréal et le passage à l’État libéral moderne (1838-1850) », Revue d’histoire urbaine/ Urban History Review, vol. 46, no 2, 2018, p. 25-41.